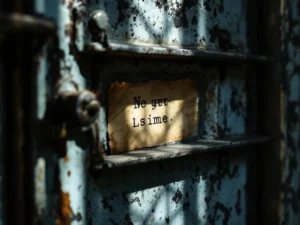Lundi 21 avril 2025 au matin, le pape François s’est éteint à l’âge de 88 ans. C’est à ce moment-là que s’ouvre la période dite de sede vacante, littéralement « siège vacant », désignant l’absence d’un pape à la tête de l’Église catholique.
La première étape, très encadrée, consiste à officialiser la mort du pape. Une tâche confiée au camerlingue, en l’occurrence le cardinal américain Kevin Farrell. En présence du maître des célébrations liturgiques, l’archevêque Diego Ravelli, le constat est désormais fait dans la chapelle privée du pontife, conformément à une récente décision du pape François. C’est également le camerlingue qui prend soin de sceller la chambre et le bureau du défunt, avant d’en notifier le doyen du collège des cardinaux.
Le fameux anneau du pêcheur, symbole de l’autorité papale, est quant à lui retiré puis détruit ou rayé pour éviter tout usage frauduleux. Un geste fort, traditionnellement chargé d’émotion.
Des adieux empreints de simplicité
Les jours suivants sont marqués par la mise en place du deuil. Comme prévu par la constitution apostolique, les funérailles ont lieu entre quatre et six jours après le décès. Contrairement à ses prédécesseurs qui reposaient dans trois cercueils emboîtés, François a souhaité une sépulture plus simple, dans un unique cercueil en bois et zinc.
Son corps est d’abord exposé à la basilique Saint-Pierre. Mais cette fois-ci, pas de catafalque surélevé. Il repose directement dans son cercueil, fidèle à sa volonté d’un hommage sobre et sans mise en scène. Pas de fermeture du cercueil en grande pompe non plus. « Tout se fera dans la même cérémonie, comme pour tout chrétien », affirmait-il dans un livre d’entretiens paru récemment.
Autre choix marquant : François a demandé à être inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans le cœur de Rome, et non dans la crypte du Vatican comme le veut la tradition. Ce lieu, très symbolique pour lui, était celui où il se recueillait avant chacun de ses voyages.
Le conclave, moment de transition et d’unité
Durant cette période de transition, les responsables de la Curie romaine cessent tous leurs fonctions, à l’exception du camerlingue. L’Église est alors gouvernée collectivement par les cardinaux, réunis chaque jour pour préparer la suite.
Entre 15 et 20 jours après la mort du pape, le conclave peut officiellement commencer. Il se tient comme le veut la tradition dans la chapelle Sixtine, à huis clos. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent y participer. Ils doivent élire, parmi eux, celui qui deviendra le 267e successeur de Saint-Pierre.
L’élection se fait à bulletins secrets. Quatre votes ont lieu chaque jour. Si aucun candidat n’obtient les deux tiers des voix, les bulletins sont brûlés avec des substances dégageant une fumée noire. En revanche, si un pape est élu, la fumée devient blanche, signalant au monde entier qu’un nouveau chapitre s’ouvre.
Habemus papam : une annonce historique
Une fois élu, le nouveau pape choisit son nom de règne. La grande cloche de la basilique Saint-Pierre retentit alors, et depuis le balcon central, le doyen des diacres — aujourd’hui le cardinal Dominique Mamberti — prononce la célèbre formule « Habemus papam » : « Nous avons un pape. »
Le nouveau souverain pontife apparaît ensuite, offre sa première bénédiction et prend la tête d’une Église en quête de continuité et d’espérance.
Avec la mort de François, une page s’est tournée, mais le souffle de l’histoire reste intact. Dans le silence de la chapelle Sixtine, les regards se tourneront bientôt vers un nouvel homme, porteur d’une mission millénaire.